
Stress chronique : comment aller mieux ?
Ventre noué, goût à rien, cœur qui bat la chamade, souffle coupé, nœud dans la gorge, pensées en pagaille… Il ne se passe pas une journée sans que le mot “stress” ne traverse notre vie. La vie professionnelle est source de stress et s’y ajoutent les exigences de la vie personnelle, créant un équilibre parfois difficile à maintenir. Lorsque ce stress devient chronique, il peut nuire à notre bien-être physique et mental. Comment différencier le stress aigu du stress chronique ? Quels sont ses effets et surtout, comment y remédier ? On fait le point.
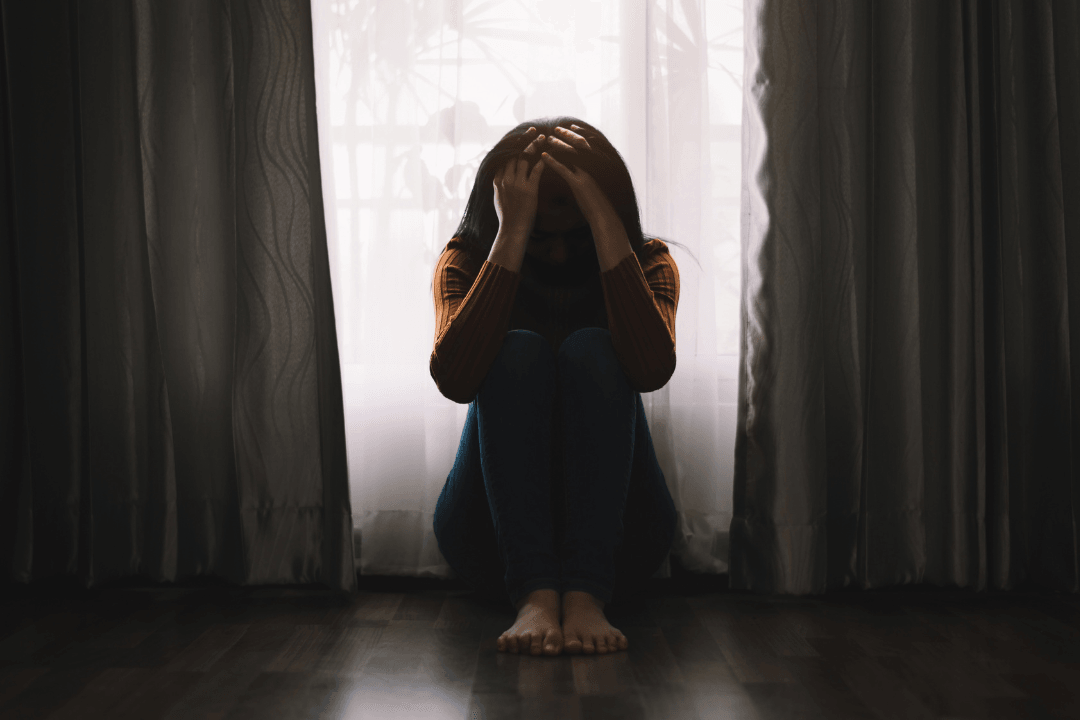
Stress aigu VS stress chronique : Quelle différence ?
Le stress aigu, une réponse “normale” de l’organisme
Le stress aigu est une réponse naturelle à un agent stressant, un événement soudain perçu comme une menace. Il est déclenché lorsque nous avons peu de contrôle sur une situation impliquant de l’imprévu, de la nouveauté ou du danger. Paradoxalement, il peut être bénéfique, car il nous permet de réagir rapidement à une menace : éviter un accident, réussir un entretien ou prendre la parole en public.
Stress chronique : définition
Le stress chronique, quant à lui, est une exposition prolongée et répétée au stress. Il résulte souvent d’un mode de vie exigeant et peut être causé par des pressions professionnelles, des soucis financiers ou des conflits familiaux. Contrairement au stress aigu, il est nocif pour notre organisme et peut entraîner divers problèmes de santé.
Phases de stress : Que se passe-t-il dans notre organisme quand nous sommes sous pression ?
La phase d’alarme
Lorsque nous sommes confrontés à un facteur de stress, nos glandes surrénales libèrent de l’adrénaline et d’autres hormones pour préparer notre corps à réagir. Nos sens se mettent en alerte maximale, nous rendant plus réactifs aux stimuli de notre environnement. Chaque son, chaque mouvement ou chaque sensation semble plus intense, comme si notre corps se préparait à réagir au moindre danger. Cette hypervigilance, bien que naturelle, peut rapidement devenir épuisante, notre cerveau analysant en permanence les informations perçues. Nos perceptions sont accrues, notre force musculaire et nos réflexes sont décuplés. Nous sommes alors en état de grande vigilance, prêts à fuir ou à affronter la situation, mobilisant toutes nos ressources pour répondre à cette pression.
La phase de résistance
Si le stress persiste, d’autres mécanismes se mettent en place. L’organisme produit du cortisol, et d’autres hormones tels que des endorphines, de la dopamine et de la sérotonine. La glycémie augmente, tout comme les niveaux de cholestérol et d’acides gras. Le système immunitaire est temporairement mis en veille. Ces adaptations permettent de maintenir un niveau de performance élevé. Cependant, si cette phase dure trop longtemps, elle peut entraîner des déséquilibres.
La phase d’épuisement
Lorsque le stress devient chronique et que l’organisme n’a plus les ressources nécessaires pour maintenir la phase de résistance, il entre dans une phase d’épuisement. Le taux de cortisol reste élevé, ce qui entraîne une détérioration progressive des fonctions physiologiques et psychologiques. L’énergie s’épuise, une fatigue anormale survient, les troubles du sommeil apparaissent, et le risque de maladies chroniques (hypertension, diabète, dépression) augmente considérablement. Le corps ne parvient plus à s’adapter et montre des signes de faiblesse généralisée, pouvant aller jusqu’au burn-out.

Les conséquences du stress chronique
-Déficit nutritionnel
Pour répondre aux besoins énergétiques, le corps métabolise rapidement les nutriments, ce qui peut entraîner une carence en minéraux, vitamines et électrolytes essentiels. De plus, l’absorption des nutriments est moins efficace en période de stress.
-Déficit immunitaire
Le cortisol affaiblit les défenses immunitaires, rendant l’organisme plus vulnérable aux infections. Il n’est pas rare que les personnes stressées tombent plus fréquemment malades.
-Troubles gynécologiques
Le stress chronique peut entraîner des irrégularités menstruelles, voire une aménorrhée chez certaines femmes. Il peut également affecter la fertilité chez les hommes et les femmes.
-Santé mentale
Le stress psychologique est associé à l’anxiété, aux crises de panique, aux phobies, aux troubles alimentaires (perte d’appétit ou grignotage compulsif) et aux dépendances, mais peut également avoir un impact sur le sommeil, la concentration et la gestion émotionnelle.
Vieillissement prématuré
Le stress chronique accélère le vieillissement cellulaire en augmentant le dommage oxydatif causé par les radicaux libres, favorisant ainsi le vieillissement prématuré.

Stress aigu VS stress chronique : Quelle différence ?
Le stress aigu, une réponse “normale” de l’organisme
Le stress aigu est une réponse naturelle à un agent stressant, un événement soudain perçu comme une menace. Il est déclenché lorsque nous avons peu de contrôle sur une situation impliquant de l’imprévu, de la nouveauté ou du danger. Paradoxalement, il peut être bénéfique, car il nous permet de réagir rapidement à une menace : éviter un accident, réussir un entretien ou prendre la parole en public.
Stress chronique : définition
Le stress chronique, quant à lui, est une exposition prolongée et répétée au stress. Il résulte souvent d’un mode de vie exigeant et peut être causé par des pressions professionnelles, des soucis financiers ou des conflits familiaux. Contrairement au stress aigu, il est nocif pour notre organisme et peut entraîner divers problèmes de santé.
Phases de stress : Que se passe-t-il dans notre organisme quand nous sommes sous pression ?
La phase d’alarme
Lorsque nous sommes confrontés à un facteur de stress, nos glandes surrénales libèrent de l’adrénaline et d’autres hormones pour préparer notre corps à réagir. Nos sens se mettent en alerte maximale, nous rendant plus réactifs aux stimuli de notre environnement. Chaque son, chaque mouvement ou chaque sensation semble plus intense, comme si notre corps se préparait à réagir au moindre danger. Cette hypervigilance, bien que naturelle, peut rapidement devenir épuisante, notre cerveau analysant en permanence les informations perçues. Nos perceptions sont accrues, notre force musculaire et nos réflexes sont décuplés. Nous sommes alors en état de grande vigilance, prêts à fuir ou à affronter la situation, mobilisant toutes nos ressources pour répondre à cette pression.
La phase de résistance
Si le stress persiste, d’autres mécanismes se mettent en place. L’organisme produit du cortisol, et d’autres hormones tels que des endorphines, de la dopamine et de la sérotonine. La glycémie augmente, tout comme les niveaux de cholestérol et d’acides gras. Le système immunitaire est temporairement mis en veille. Ces adaptations permettent de maintenir un niveau de performance élevé. Cependant, si cette phase dure trop longtemps, elle peut entraîner des déséquilibres.
La phase d’épuisement
Lorsque le stress devient chronique et que l’organisme n’a plus les ressources nécessaires pour maintenir la phase de résistance, il entre dans une phase d’épuisement. Le taux de cortisol reste élevé, ce qui entraîne une détérioration progressive des fonctions physiologiques et psychologiques. L’énergie s’épuise, une fatigue anormale survient, les troubles du sommeil apparaissent, et le risque de maladies chroniques (hypertension, diabète, dépression) augmente considérablement. Le corps ne parvient plus à s’adapter et montre des signes de faiblesse généralisée, pouvant aller jusqu’au burn-out.
ANTI-STRESS
NOS PRODUITS
-
 NouveautéPrix habituel €12,10 EURPrix habituelPrix unitaire / par
NouveautéPrix habituel €12,10 EURPrix habituelPrix unitaire / par -
 Best-sellerPrix habituel €12,00 EURPrix habituelPrix unitaire / par
Best-sellerPrix habituel €12,00 EURPrix habituelPrix unitaire / par -
 NouveautéPrix habituel €9,90 EURPrix habituelPrix unitaire / par
NouveautéPrix habituel €9,90 EURPrix habituelPrix unitaire / par -
 Exclusivité webPrix habituel €31,30 EURPrix habituelPrix unitaire / par
Exclusivité webPrix habituel €31,30 EURPrix habituelPrix unitaire / par€36,80 EURPrix promotionnel €31,30 EURExclusivité web -
 Best-sellerPrix habituel €9,60 EURPrix habituelPrix unitaire / par
Best-sellerPrix habituel €9,60 EURPrix habituelPrix unitaire / par -
 NouveautéPrix habituel €11,30 EURPrix habituelPrix unitaire / par
NouveautéPrix habituel €11,30 EURPrix habituelPrix unitaire / par -
 NouveautéPrix habituel €14,60 EURPrix habituelPrix unitaire / par
NouveautéPrix habituel €14,60 EURPrix habituelPrix unitaire / par -
 NouveautéPrix habituel €14,90 EURPrix habituelPrix unitaire / par
NouveautéPrix habituel €14,90 EURPrix habituelPrix unitaire / par -
 NouveautéPrix habituel €13,90 EURPrix habituelPrix unitaire / par
NouveautéPrix habituel €13,90 EURPrix habituelPrix unitaire / par -
 NouveautéPrix habituel €9,90 EURPrix habituelPrix unitaire / par
NouveautéPrix habituel €9,90 EURPrix habituelPrix unitaire / par











